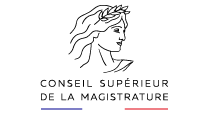Avis du 16 octobre 1997
Il a été rappelé, dans les deux premiers rapports d'activité, que le Conseil supérieur de la magistrature reçoit de l'article 64 de la Constitution la mission d'assister le Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Cette mission d'assistance conduit d'abord le Conseil à répondre aux demandes d'avis que lui adresse le Chef de l'Etat. Une seule demande a été présentée au cours de la période de référence, le 22 décembre 1994, concernant l'éventuel dessaisissement d'un magistrat instructeur : il a, dans le rapport 1995, été rendu compte de la teneur de l'avis qui a alors été remis au Président de la République et publié par lui.
En outre, le Conseil a considéré que l'article 64 de la Constitution lui donne aussi, en dehors de toute demande expresse, le pouvoir de faire connaître au Président de la République son avis sur les grandes questions relatives à l'indépendance de la magistrature.
Un débat national s'étant instauré, à l'initiative du Président de la République, sur les grandes orientations d'une possible réforme et au vu des conclusions de la commission de réflexion sur la justice, il est apparu au Conseil que sa mission lui imposait de faire connaître ses vues au Chef de l'Etat.
Il l'a fait à deux reprises : le 19 décembre 1996, puis le 16 octobre 1997. Le premier de ces deux avis a été publié dans le rapport 1996, au titre des propositions du Conseil. La teneur du second inspire, pour une large part, ses réflexions telles qu'elles sont présentées ci-dessous, sur l'avenir de l'institution judiciaire.
Par ailleurs, le garde des sceaux a demandé à plusieurs reprises l'opinion du Conseil sur des questions relatives à l'institution judiciaire.
En revanche, le Conseil s'est refusé à toute consultation lorsqu'il était interrogé par d'autres instances, estimant que son pouvoir d'avis ne pouvait excéder ses compétences constitutionnelles.
LES GRANDS AXES D'UNE POSSIBLE RÉFORME
En même temps qu'il a cherché à assurer pleinement ses diverses missions, le Conseil s'est, d'une manière constante, préoccupé de l'avenir de l'institution judiciaire.
Ses réflexions ont ainsi porté sur le Conseil lui-même ; sur les liens devant exister entre le ministre de la justice et les parquets ; enfin sur le contrôle des magistrats et les diverses formes qu'il peut prendre.
A. - Le Conseil supérieur de la magistrature et ses attributions
Les modifications qui seraient apportées aux conditions de nomination des magistrats du parquet auraient-elles mêmes - quelle que soit leur ampleur - des conséquences sur la composition et les attributions du Conseil.
1. Les principes
L'exigence d'un avis conforme du Conseil pour la nomination des magistrats du parquet constituerait un incontestable progrès, dès lors que serait, par là même, donnée à un organe constitutionnel indépendant du pouvoir politique la possibilité de faire obstacle à toute nomination qu'il estimerait partisane.
Une telle réforme ne peut être envisagée qu'à la condition qu'elle s'applique effectivement à tous les magistrats : les procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel devraient donc cesser d'être nommés en conseil des ministres et réintégrer le droit commun des nominations.
Surtout, cette réforme ne suffirait pas à réaliser une véritable assimilation des magistrats du siège et du parquet si le pouvoir de proposition existant pour les uns n'était pas étendu aux autres.
En outre, la volonté d'écarter toute suspicion, notamment sur le choix des magistrats appelés à exercer l'action publique (procureurs généraux et procureurs de la République), conduit certainement à donner, en ce qui les concerne, un pouvoir de proposition au Conseil.
2. Les conséquences
Ainsi conçue, l'unification, sans aucune réserve, des modalités de nomination des magistrats aurait pour conséquence inéluctable une réforme de l'organisation du Conseil.
La dualité qui existe actuellement au sein du Conseil n'aurait plus alors de raison d'être et les deux formations spécialisées, du siège et du parquet, devraient disparaître au profit d'un Conseil unique et statuant, dans les mêmes conditions, pour l'ensemble des magistrats.
Dans cette hypothèse, les magistrats siégeant au Conseil réformé représenteraient, en fonction des effectifs respectifs, à la fois le siège et le parquet. Ils devraient aussi, autant que faire se peut, représenter l'ensemble des sensibilités professionnelles.
Quant à la nécessité, souvent invoquée, de composer le Conseil d'une majorité de personnalités extérieures à la profession, elle devrait s'apprécier à la lumière de la recommandation R 94.12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Aux termes de celle-ci " l'autorité compétente en matière de sélection et de carrière des juges devrait être indépendante du gouvernement et de l'administration. Pour garantir son indépendance, des dispositions devraient être prévues pour veiller, par exemple, à ce que ses membres soient désignés par le pouvoir judiciaire et que l'autorité décide elle-même de ses propres règles de procédure ".
Par ailleurs, l'idée selon laquelle la vice-présidence du Conseil pourrait être assurée, non plus par le garde des sceaux, comme actuellement, mais par l'une des personnalités désignées par le Président de la République n'offrirait pas que des avantages.
Une pratique de quatre ans incline le Conseil à penser que la présence du garde des sceaux, au stade final des discussions, s'avère hautement utile. Elle ouvre en effet un dialogue souvent fructueux sur les raisons qui ont conduit le Conseil, en délibéré, à formuler des avis conformes ou non conformes aux propositions du ministre. Ce contact devrait être maintenu, quelle que soit la qualité institutionnelle en laquelle le garde des sceaux interviendrait (vice-président, membre ou autorité de proposition).
En toute hypothèse, les réunions de travail délibératives devraient, comme aujourd'hui, être présidées par un membre élu en son sein par le Conseil.
Enfin se pose le problème de la mémoire de l'institution. Les membres du Conseil exercent actuellement un mandat d'une durée de quatre ans non immédiatement renouvelable, ce qui constitue objectivement un gage d'indépendance. Il conviendrait cependant que soit assurée une continuité de doctrine et d'action des Conseils successifs, selon une formule minimale de rotation ou de renouvellement partiel respectueuse du principe d'égalité entre les membres élus et désignés.
Quant aux attributions du Conseil, elles devraient être complétées.
L'octroi de pouvoirs plus étendus pour la nomination des magistrats du parquet doit avoir pour corollaire un rôle nouveau, à l'égard des mêmes magistrats, en matière disciplinaire, le Conseil étant désormais appelé à prendre lui-même la décision et non plus seulement à émettre un avis.
Donner aux chefs de cour, selon des modalités à définir, la possibilité de saisir le Conseil, concurremment avec le garde des sceaux, aurait par ailleurs l'avantage de remédier aux disparités qui peuvent naître de politiques différentes de la part de gardes des sceaux successifs.
Il n'est sans doute pas nécessaire, en revanche, de redéfinir les missions du Conseil dans le domaine des avis, ces pouvoirs trouvant un fondement juridique suffisant dans la mission d'assistance conférée par l'article 64 de la Constitution.
Une modification par l'effet de laquelle le Conseil ne donnerait d'avis que sur la demande du Président de la République constituerait, à cet égard, un incontestable recul par rapport à la pratique actuelle.
Il est rappelé, en effet, que, dans des circonstances qu'ils ont estimées suffisamment exceptionnelles pour justifier une telle initiative, les membres de la formation du parquet ont, de façon spontanée, remis un avis écrit au Président de la République. Ils l'ont fait après avoir constaté :
- d'une part, que si l'article 64 de la Constitution ne prévoit pas expressément une telle possibilité, il ne l'interdit pas davantage ;
- d'autre part, que la notion même d'assistance, fondement de la mission d'avis, implique que cette assistance puisse être donnée en dehors d'une demande expresse de celui qui en bénéficie.
En toute hypothèse, et en présence de ce précédent - fût-il unique -, toute limitation qui interviendrait dans le cadre des réformes en cours risquerait d'être interprétée comme révélant une certaine volonté d'empêcher le Conseil de s'exprimer. On voit mal, en effet, ce qui conduirait à interdire à un organe de réflexion - tenant son existence de la Constitution, comprenant en son sein non seulement les représentants élus de la profession mais aussi des personnalités précisément choisies en fonction de l'intérêt qu'elles portent à la justice - de communiquer à son président, au demeurant en toute confidentialité, le fruit de travaux légitimement entrepris sur une question relevant de sa compétence.
B. - Les liens entre le ministre de la justice et les parquets
1. Les rôles respectifs du ministre de la justice et des parquets
Chargé de mettre en ouvre, en matière criminelle, la politique du gouvernement dont il est membre, le ministre de la justice doit conserver la charge de la coordination et de l'harmonisation qui s'imposent dans l'exercice de l'action publique. C'est donc à lui - dûment informé par les parquets des faits pouvant entraîner, ou ayant entraîné, des poursuites judiciaires - qu'il revient de définir les grandes orientations ainsi que les objectifs à atteindre et de donner aux magistrats du ministère public, par voie de circulaires, toutes instructions d'ordre général qui lui paraissent opportunes.
En revanche, l'application de la politique pénale ainsi définie, c'est-à-dire la décision sur la mise en ouvre de l'action publique, doit relever localement de la seule responsabilité du ministère public.
2. Les modalités d'exercice de l'action publique
a) L'initiative réservée au ministère public
Ainsi conçue, la répartition des compétences entre le ministre de la justice et les parquets implique que le garde des sceaux perde toute possibilité de donner des instructions, écrites ou orales, concernant le déroulement proprement dit des procédures en cours.
C'est sans doute à tort que certains commentateurs ont vu dans une réforme en ce sens - et souvent pour la déplorer - l'émergence d'une " indépendance des procureurs " : cette réforme, en effet, doit être considérée comme bénéficiant, non au chef d'un parquet déterminé, mais au ministère public pris dans son ensemble. En toute hypothèse, la liberté d'action ainsi reconnue aux parquets se heurte, en fait, à trois limites :
- L'exercice de l'action publique doit, tout d'abord et sous les sanctions évoquées ci-dessous, se situer dans le cadre des instructions générales données par le garde des sceaux.
- Il ne se conçoit, ensuite, que dans le respect du pouvoir hiérarchique inhérent à l'organisation du ministère public : il en résulte que le procureur général, chargé d'harmoniser dans le ressort de sa cour d'appel l'action des parquets, a par là même vocation à donner aux procureurs de la République agissant sous son autorité toutes instructions qu'il juge utiles, y compris dans les procédures particulières, dès lors que ces instructions sont écrites et versées au dossier. Le pouvoir ainsi reconnu au procureur général ne saurait désormais être considéré avec suspicion : nommé sur la proposition du Conseil, choisi, en fonction de ses seules compétences, par un organe indépendant du pouvoir politique, le procureur général ne pourra plus, en effet, être regardé comme le mandataire, désigné intuitu personae, de ce pouvoir et sa légitimité sera de même nature que celle que personne ne conteste à son homologue, le premier président de la cour d'appel.
- Les décisions prises par les parquets - spécialement les décisions de classement sans suite - peuvent, enfin, être remises en cause par l'exercice des recours examinés ci-après.
Sous ces réserves, l'impossibilité, pour le ministre de la justice, d'agir sur le cours des poursuites doit nécessairement s'appliquer, sans distinction, à toutes les procédures.
Une interdiction qui ne concernerait que certaines procédures (le critère pouvant être, alors, celui d'éventuelles incidences politiques) conduirait sans nul doute à des difficultés d'application - car il faudrait définir avec rigueur la limite entre les deux catégories d'affaires - et à des interprétations malveillantes.
De même, la notion d'ordre public ou d'intérêt général - à laquelle on pourrait recourir pour autoriser le garde des sceaux à donner des instructions aux parquets concernés - est elle-même un concept trop imprécis, toute infraction, même la plus vénielle, portant en soi une atteinte à l'ordre public. Il est rappelé, à cet égard, que le reproche a bien souvent été fait aux magistrats de recourir à une notion aussi vague pour motiver - mais seulement d'une manière formelle, a-t-on dit - leurs décisions de placement ou de maintien en détention provisoire.
b) Le rôle de la police judiciaire
Il ne saurait y avoir d'autorité judiciaire indépendante sans neutralité des services de police judiciaire et sans indépendance de ceux-ci par rapport aux autres pouvoirs de l'Etat.
Pour remplir utilement leurs fonctions dans le domaine de l'action publique, les magistrats du parquet, comme les magistrats instructeurs, doivent pouvoir exercer pleinement leurs prérogatives à l'égard des services de police judiciaire : l'indépendance de l'autorité judiciaire ne peut être, en effet, garantie que si les magistrats du parquet - au stade de l'enquête préliminaire - et les juges d'instruction - au stade de l'information - trouvent, à leurs côtés, des officiers de police judiciaire partageant les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs.
Quelle que soit son origine, l'officier de police judiciaire agit aujourd'hui sous " la direction " du procureur de la République, " la surveillance " du procureur général et " le contrôle " de la chambre d'accusation.
Est ainsi rendue possible, entre magistrats et officiers de police judiciaire, une action concertée sur des objectifs communs et il convient de souligner que, dans la majorité des cas, la collaboration entre les uns et les autres se révèle d'une grande efficacité et se réalise de manière parfaitement satisfaisante.
Le statut des officiers de police judiciaire recèle cependant diverses particularités, qui procèdent de l'histoire ou de simples considérations administratives, mais qui peuvent aujourd'hui faire naître l'équivoque quant à l'autorité à laquelle ils sont effectivement soumis.
Les officiers de police judiciaire - même lorsqu'ils sont exclusivement affectés à des fonctions de ce type - continuent, notamment, d'appartenir à leur corps d'origine (commissaires ou officiers de police ; officiers ou sous-officiers de gendarmerie.) et exercent leurs fonctions dans un cadre hiérarchique relevant de leur seul ministre de tutelle (ministre de l'intérieur ou de la défense), lequel demeure ainsi, en fait, le seul maître du déroulement de leur carrière.
C'est, en outre, la structure administrative dans laquelle ils travaillent qui donne aux officiers de police judiciaire les moyens matériels de leur action et détermine, en fait, les priorités dans les affaires à traiter, de sorte que l'enquête préliminaire prescrite par un parquet ou la commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction peut se trouver paralysée, ou suspendue, si l'autorité administrative en a décidé ainsi.
Au-delà de l'équivoque, le régime actuel des officiers de police judiciaire peut donc entraîner la suspicion - le plus souvent injustifiée - quant à leur indépendance à l'égard du pouvoir politique : une suspicion qui s'est trouvée confortée par certains événements récents, que le statut actuel n'a pas permis d'éviter.
On a pu voir, ainsi, un directeur de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris qui, ayant refusé de déférer à la réquisition d'un juge d'instruction, a été privé de son habilitation par décision de justice, sans que celle-ci ait entraîné la conséquence qu'elle aurait dû emporter, dès lors que ce fonctionnaire a été maintenu dans son poste.
Le constat ainsi fait, met en évidence la nécessité de trouver une solution au problème posé.
Il n'appartient pas au Conseil de faire, en la matière, des propositions précises. Il ne dispose pas, au demeurant, des éléments d'information qui lui permettraient de mesurer et de maîtriser l'ensemble des incidences statutaires qu'aura nécessairement toute réforme.
Il estime cependant que la solution doit être recherchée dans un rapprochement plus grand des services de police judiciaire par rapport à l'autorité judiciaire.
c) Le droit propre de saisine du garde des sceaux
Les membres du Conseil ne sont pas favorables à l'octroi au garde des sceaux d'un droit propre de saisir les juridictions, notamment les juridictions pénales, et de la possibilité, pour celui-ci, de faire présenter des observations par un magistrat de la chancellerie ou par un avocat : il leur apparaît, en effet, que de telles dispositions seraient à la fois contraires à la conception française du ministère public et sources de difficultés d'application alors même que leur utilité peut être contestée.
Dans cette conception, les magistrats du parquet - par essence défenseurs de l'intérêt général - sont naturellement, dans le domaine judiciaire, les représentants de l'Etat et le gouvernement ne saurait donc avoir d'autres mandataires auprès des juridictions que les magistrats du ministère public, membres à part entière de ces dernières. Donner à la République d'autres " procureurs " que les procureurs de la République serait remettre en cause la notion même de ministère public.
La mise en ouvre d'un tel dispositif conduirait, par ailleurs, à de graves difficultés d'application.
L'intervention d'un magistrat de la chancellerie, ou d'un avocat, pour exercer des poursuites qu'aurait, par hypothèse, refusées le procureur de la République constituerait un désaveu public de ce dernier. Le chef du parquet se trouverait ainsi disqualifié pour intervenir ultérieurement dans la procédure puisque, quoi qu'il fasse, il serait regardé comme faisant preuve soit d'obstination, soit de soumission.
Sauf à imaginer que le magistrat de la chancellerie, ou l'avocat, userait lui-même, dans l'affaire considérée et à tous les stades de la procédure, des prérogatives du procureur de la République, il n'existerait alors, dans une telle situation, d'autre solution que de dessaisir systématiquement la juridiction naturellement compétente, avec toute la lourdeur et les inconvénients inhérents à cette procédure.
Enfin, la nécessité de recourir à un tel dispositif n'apparaît pas clairement. Si, en effet, une décision de classement sans suite est désapprouvée par le ministre de la justice, deux cas doivent être envisagés :
- ou bien la décision prise par le chef du parquet est considérée comme concrétisant un refus injustifié de se conformer aux instructions d'ordre général données par le garde des sceaux : cette décision doit alors pouvoir être remise en cause et elle pourrait l'être selon les modalités examinées ci-dessous. L'existence d'une faute disciplinaire peut, en outre, être caractérisée, faute sur laquelle le Conseil serait appelé à se prononcer, au besoin dans le cadre d'une procédure d'urgence ;
- ou bien, rien ne permet de tenir la décision pour abusive : elle relève alors du pouvoir d'appréciation appartenant au chef du parquet, sous le contrôle du procureur général. Donner, dans une telle hypothèse, au garde des sceaux le pouvoir d'agir sur le cours des poursuites viderait de sa substance le principe, institué par ailleurs, de la liberté d'action des parquets.
d) Les recours
La nécessité d'instituer un recours contre les décisions des magistrats du parquet (en fait, essentiellement les décisions de classement sans suite) ne saurait être contestée : le recours est l'indispensable contrepartie de la plus grande liberté reconnue aux parquets et son existence n'est nullement en contradiction avec les principes de fonctionnement du ministère public.
L'importance statistique des recours susceptibles d'être ainsi exercés ne doit pas, au demeurant, être surévaluée, les victimes d'infractions pénales invoquant un préjudice personnel trouvant déjà dans la loi la possibilité de contraindre le ministère public à agir en se constituant parties civiles.
Le recours ne peut donc être envisagé qu'au profit des tiers non victimes qui justifient cependant d'un intérêt à agir. On peut penser, parmi d'autres, à des associations ne remplissant pas les conditions légales pour pouvoir se constituer parties civiles ; aux membres d'une association ou aux habitants d'une commune seule habilitée à se constituer mais qui s'abstiendrait de le faire.
Il importe de souligner que la décision de classement sans suite est un acte de la fonction du procureur de la République. Dès lors son bien-fondé et son opportunité ne peuvent être appréciés que dans le respect des principes qui gouvernent l'organisation judiciaire tout entière.
A cet égard, la saisine d'une simple commission administrative - fût-elle composée de membres des plus hautes juridictions - ne repose sur aucun fondement juridique incontestable. De surcroît, le recours à une telle commission, étrangère aux impératifs d'une politique pénale, risquerait de compromettre l'application de cette politique.
Seule une juridiction - ou, à tout le moins, une autorité - de l'ordre judiciaire peut avoir qualité pour être utilement saisie et rendre une décision en appliquant, à l'exclusion de tout autre critère, les règles de droit concernant l'exercice de l'action publique.
Un filtrage effectué par le procureur général près la Cour de cassation ne permettrait sans doute pas de donner à la commission une légitimité suffisante. Nommé sur la proposition du Conseil, ce haut magistrat ne pourrait plus être présenté comme nécessairement proche du pouvoir exécutif. Mais - en raison même des fonctions qu'il exerce et pas plus que les autres magistrats de la Cour de cassation : juges du droit ou commissaires de la loi - le procureur général n'a de vocation incontestable à statuer sur l'opportunité de poursuites pénales. Et les membres du Conseil d'Etat ou les magistrats de la Cour des comptes sont dans la même situation.
En revanche, un recours porté devant le chef hiérarchique à l'autorité duquel est soumis le procureur de la République - à savoir le procureur général près la cour d'appel - aurait l'avantage d'être conforme aux principes d'organisation du ministère public et de remettre la décision à un magistrat dont la légitimité est par ailleurs renforcée et dont l'une des fonctions essentielles est précisément de veiller, dans le ressort de sa cour d'appel, à l'application de la loi pénale.
Dans le même esprit, il est essentiel que la possibilité soit parallèlement donnée au garde des sceaux lui-même - dans la mesure où pourrait être invoqué un refus de déférer aux instructions d'ordre général existant en la matière - de provoquer un nouvel examen, par le procureur général, de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République. Qu'il statue sur le recours d'un tiers ou qu'il procède sur la demande du garde des sceaux à une seconde lecture du dossier, le procureur général - auquel appartiendrait, en toute hypothèse, la décision finale - demeurerait dans le cadre strict des prérogatives que la loi lui confère.
C. - Le contrôle des magistrats
L'essentiel du contrôle de l'action du " juge " - au sens large - se situe tout naturellement dans la mise en ouvre des diverses voies de recours et, pour ce qui est du parquet, dans l'exercice du pouvoir hiérarchique : l'appel permettra de corriger les erreurs prêtées au premier juge ; le pourvoi en cassation de redresser les erreurs de droit imputées à la cour d'appel ; ses pouvoirs permettent au chef de parquet de coordonner l'action des substituts placés sous son autorité.
Ce contrôle, purement juridictionnel, peut cependant dans certaines situations se révéler insuffisant : les solutions appropriées doivent alors être recherchées à deux niveaux différents, ceux :
- de la mutation dans l'intérêt du service,
- de la responsabilité des magistrats.
1. La mutation dans l'intérêt du service
Le garde des sceaux est fondé, au nom de l'intérêt du service, à procéder à la mutation d'un magistrat du parquet ou de l'administration centrale de la chancellerie.
L'intérêt du service est le nom donné à l'intérêt général dans le droit de la fonction publique. En vue d'assurer la bonne marche du service public, l'administration peut déplacer un fonctionnaire, dans le respect des garanties auxquelles celui-ci peut prétendre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
- En l'occurrence, il s'agit d'une mesure de sauvegarde ou de protection du service public consécutive à un comportement préjudiciable de l'un de ses agents. De sorte que la mutation s'analyse en une manifestation du pouvoir hiérarchique et non point du pouvoir disciplinaire. Cette distinction fondamentale découle, selon la jurisprudence, de la finalité poursuivie par l'autorité administrative. Le pouvoir hiérarchique est fondé sur une considération d'intérêt public, à l'opposé du pouvoir disciplinaire, qui sanctionne un manquement d'un fonctionnaire à une obligation de service.
Il s'ensuit deux conséquences : la mesure hiérarchique qui ne revêt pas l'aspect d'une sanction est soustraite à l'obligation de motivation, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; par ailleurs, la mesure hiérarchique s'applique à tous les fonctionnaires et agents publics à l'exclusion de ceux qui peuvent se prévaloir de l'inamovibilité, tels les magistrats du siège ou les professeurs d'université.
- La mutation dans l'intérêt du service est entourée des garanties découlant des droits de la défense. A ce titre, le magistrat doit être reçu par le ministre, avoir accès à son dossier. La mutation figure, quand il y a lieu, à la transparence adressée aux juridictions.
- S'agissant de l'étendue du contrôle juridictionnel, le Conseil d'Etat (décision Monnet 19 avril 1991), s'attache à vérifier l'authenticité de la mesure hiérarchique en vue de débusquer, le cas échéant, une mesure disciplinaire camouflée.
Au prix d'une simplification, le juge apprécie, tout à la fois, en dehors du contrôle minimal de l'erreur manifeste d'interprétation, l'intention de l'administration et la gravité de la mesure prise à l'encontre du magistrat. En règle générale, une gravité exceptionnelle est regardée comme le réactif d'une sanction disciplinaire déguisée. Dans cet ordre d'idées, une modification de la situation indiciaire du magistrat (la perte d'une lettre dans la hiérarchie des rémunérations) n'a pas été considérée par le juge administratif, dans la décision précitée, comme une rétrogradation ou un abaissement d'échelon, au sens de l'échelle des sanctions disciplinaires (art. 45 de l'ordonnance modifié du 22 décembre 1958), dès lors que les emplois classés hors hiérarchie de la magistrature relèvent d'un même groupe de rémunérations (arrêté du 8 avril 1977). A cet égard, ce dernier arrêté revêt une portée uniquement financière sans incidence sur la situation statutaire du magistrat intéressé.
Compte tenu de la frontière incertaine entre la notion d'intérêt du service et la faute disciplinaire, le Conseil s'est attaché à requalifier au cas par cas les fautes invoquées au soutien de la mesure proposée.
C'est ainsi, qu'après avoir entendu un magistrat du parquet, la formation a émis un avis favorable à sa mutation dans le respect des principes susmentionnés.
En revanche, en une autre occasion, le Conseil, après avoir reçu l'intéressé, a, en émettant un avis négatif dûment motivé, fait échec à une mutation présentée comme de droit commun, mais qui lui était apparue comme dictée par l'intérêt du service tel que l'avait alors apprécié le garde des sceaux.
2. La responsabilité des magistrats
L'octroi aux magistrats du parquet d'une plus grande liberté d'action conduit nécessairement à une redéfinition des conditions dans lesquelles peut être mise en ouvre leur responsabilité, aucune distinction de principe ne pouvant cependant être faite, à cet égard, entre les magistrats du parquet et ceux du siège.
Il doit d'abord être rappelé qu'en dehors même de toute recherche de responsabilité individuelle, les personnes ayant souffert d'un mauvais fonctionnement de l'institution judiciaire peuvent obtenir indemnisation.
C'est le cas, notamment, des victimes d'erreurs judiciaires après révision de leur condamnation (article 626 du code de procédure pénale) ou, sous certaines conditions, des personnes ayant été provisoirement détenues avant de bénéficier d'une décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe (article 149 du code de procédure pénale).
Le magistrat est, par ailleurs, responsable de ses actes.
Il répond naturellement, devant la juridiction pénale, des infractions susceptibles de lui être imputées dans l'exercice de ses fonctions.
Il répond également, devant la juridiction disciplinaire, des manquements professionnels commis dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
A cet égard, il doit être relevé qu'après révision du rôle du ministère public, une faute disciplinaire d'un nouveau type pourrait, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, se trouver caractérisée : celle que constituerait un refus avéré de respecter les instructions générales données par le garde des sceaux. Elle ne saurait toutefois être confondue avec les comportements justifiant de la part du ministre de la justice les mesures prises dans l'intérêt du service, lesquelles restent soumises à l'appréciation du Conseil et au contrôle du juge administratif.
La véritable difficulté demeure donc celle de la responsabilité civile du magistrat en présence de dommages qui résulteraient d'un acte juridictionnel (pour un magistrat du siège) ou d'un acte de la fonction (pour un magistrat du parquet) alors même que, par l'effet des recours, la décision dommageable a pu être rétractée, réformée, ou annulée.
Les conditions et les modalités de mise en ouvre d'une telle responsabilité sont clairement définies par la loi, en l'espèce l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 11-1 de l'ordonnance du 21 décembre 1958 (loi organique du 18 janvier 1979). Aucune disposition réglementaire n'est encore intervenue.
Selon ces textes, seule une faute lourde peut fonder une action en responsabilité, l'action devant être dirigée contre l'Etat lui-même, lequel dispose ensuite d'un recours contre le magistrat concerné. Il peut être ici rappelé que la faute lourde a - très récemment encore - été définie par la première chambre de la Cour de cassation comme " celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat ou un fonctionnaire de justice, normalement soucieux de ses devoirs, n'y eût pas été entraîné ".