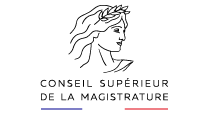Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet
La commission de discipline du parquet, sur la poursuite disciplinaire exercée à l’encontre de M. X, procureur de la République près le tribunal de grande instance de V,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, notamment les articles 63, 64 et 65 de ce texte ;
Vu la dépêche en date du 6 mars 1987 de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, transmettant le dossier personnel de M. X, procureur de la République près le tribunal de grande instance de V, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la commission de discipline du parquet, et le priant de réunir la commission afin de lui soumettre, pour avis, les faits reprochés à M. X ;
Vu les auditions, d’une part en date des 14 mai et 5 juin 1987 de M. X, son dossier personnel lui ayant été préalablement communiqué et mis à la disposition de ses conseils par M. Michel Montanier, avocat général à la Cour de cassation, désigné en qualité de rapporteur par arrêté de M. le procureur général près la Cour de cassation le 13 avril 1987, et d’autre part en date des 25 mai 1987 et 1er juin 1987, respectivement de M. C, président du tribunal de grande instance de V, et de M. D, procureur général près la cour d’appel de B ;
Considérant que M. X a comparu le 8 octobre 1987 devant la commission de discipline du parquet, assisté de Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et de Mme Nicole Obrego, vice-président au tribunal de grande instance de Valence ; que M. Viricelle, directeur des services judiciaires au ministère de la justice, a été entendu ; que M. X et ses conseils, le directeur des services judiciaires et les membres de la commission ont dispensé M. Montanier de la lecture de son rapport qui leur avait été préalablement communiqué ; que Me Lyon-Caen et Mme Obrego sont intervenus ; que M. X a fourni ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés et a eu la parole le dernier ; que l’affaire a été mise en délibéré, M. X étant informé que l’avis serait porté à sa connaissance le 9 octobre 1987 ;
Considérant que le 8 janvier 1987, lors de l’audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de V, M. X a prononcé, en sa qualité de procureur de la République, devant les personnalités présentes, un discours, dont le texte est annexé au présent avis, traitant du problème de la toxicomanie ;
Considérant qu’à la suite de ce discours, le garde des sceaux a envisagé la mutation de M. X « dans l’intérêt du service » à un poste de premier substitut près le tribunal de grande instance de W, mais que le projet de décret préparé au ministère de la justice n’a pas obtenu l’agrément de M. le Président de la République ; que le garde des sceaux a alors proposé de nommer M. X président de chambre à la cour d’appel de Y, affectation que celui-ci avait demandée par requête du 29 décembre 1986 ; que ce projet de mouvement a été diffusé dans les juridictions le 13 février 1987 et inscrit à l’ordre du jour de la séance du 19 février 1987 du Conseil supérieur de la magistrature, présidée par le garde des sceaux ; que le Conseil supérieur a émis un avis défavorable ;
Considérant que le garde des sceaux a alors saisi la commission de discipline du parquet le 6 mars 1987, en application de l’article 63 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Considérant que le garde des sceaux estime que M. X a commis une faute disciplinaire au sens de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, caractérisée par :
- un manquement à l’obligation de réserve « en se livrant publiquement à une critique de la loi » et « en mettant en cause l’action du gouvernement dans un domaine où celui-ci s’était clairement engagé malgré une polémique que M. X a contribué à relancer, se livrant ainsi à une démonstration de nature politique » ;
- un manquement aux obligations découlant de la subordination hiérarchique « en décriant la politique du gouvernement et son application par le garde des sceaux » ;
Considérant qu’à l’appui de ces griefs, le garde des sceaux soutient que la circonstance d’une audience solennelle de rentrée d’un tribunal de grande instance ne permettait à M. X ni de se prévaloir du principe de la liberté de parole à l’audience prévue aux articles 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et 33 du code de procédure pénale, textes applicables aux seules audiences juridictionnelles, ni d’aborder un sujet d’actualité eu égard aux termes de l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire ;
La commission, après en avoir délibéré :
Sur la liberté de parole à l’audience et les dispositions de l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire
Considérant que la liberté d’expression de tout citoyen ne peut être entravée ou limitée que par la loi et dans les cas qu’elle prévoit (cf. Constitution du 4 octobre 1958, dont le préambule se réfère à la Déclaration des droits de l’homme de 1789) ;
Considérant que l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature dispose que « les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre » ; que l’article 33 du code de procédure pénale énonce : « le ministère public développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice » ;
Que le premier de ces textes a une portée générale ; qu’il s’ensuit que la liberté de parole appartient aux magistrats du ministère public à toutes les audiences où leur présence est requise ; qu’il en est ainsi de l’audience solennelle de rentrée prévue par l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Que cet article, qui précise qu’à l’occasion de l’audience solennelle tenue chaque année par les cours et tribunaux, il est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée – exposé pouvant être précédé dans les cours d’appel par un discours portant sur un sujet d’actualité ou sur un sujet juridique ou judiciaire – n’a que valeur indicative et en toute hypothèse n’énonce aucune interdiction ; que certains tribunaux de grande instance connaissent la pratique de discours de rentrée portant sur des sujets généraux ou d’actualité ;
Qu’en statuant dans une instance civile mettant en cause M. X à raison de son discours, le tribunal de grande instance de Z, dans un jugement du 1er juillet 1987 non frappé d’appel à ce jour, a exactement observé qu’en prononçant un discours sur un sujet d’actualité, M. X « se trouvait à l’évidence dans l’exercice de ses fonctions, participant ainsi au service public de la justice, même si le texte susmentionné ne prévoit de tels discours que dans les cours d’appel, sans toutefois en exclure formellement l’éventualité dans les autres juridictions » ;
Considérant que l’article R. 711-2 précité concerne l’administration de la justice, l’organisation judiciaire, le service des tribunaux et la tenue des audiences ; que cette disposition, de nature réglementaire, ne peut avoir pour effet d’entraver ou limiter même implicitement la liberté de parole à l’audience garantie par la loi organique ;
Qu’en conséquence M. X bénéficiait de la liberté de parole à l’audience de rentrée de sa juridiction ;
Sur les manquements aux obligations découlant de la subordination hiérarchique et au devoir de réserve
Considérant que la liberté de parole à l’audience est expressément instituée par l’article 5 in fine de l’ordonnance statutaire comme une dérogation au principe de la subordination hiérarchique du magistrat du parquet et qu’elle a pour effet de soustraire ce dernier à la direction et au contrôle de ses chefs hiérarchiques comme à l’autorité du garde des sceaux, pour ne le soumettre qu’aux commandements de sa seule conscience ; qu’ainsi il ne peut être imputé à M. X un manquement aux obligations découlant de la subordination hiérarchique ;
Considérant cependant que le principe de la liberté de parole à l’audience ne constitue pas une immunité au profit du magistrat du parquet ; que le représentant du ministère public prenant la parole à l’audience, n’est pas affranchi des obligations liées au devoir de réserve, ni autorisé à toutes les licences ;
Que l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 prévoit dans ses deux premiers alinéas :
« Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire » ;
« Toute manifestation d’hostilité au principe et à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions » ;
Considérant que cette obligation de réserve, dont les contours n’ont été que partiellement définis par la jurisprudence, est justifiée par le souci d’éviter que soient mises en cause l’impartialité et la neutralité des magistrats ; qu’il s’agit là d’une garantie pour les justiciables ;
Que dans cet esprit le garde des sceaux, répondant le 23 août 1975 à la question écrite d’un parlementaire, a précisé : « il est incontestable que si l’obligation de réserve imposée aux magistrats ne porte pas atteinte à leur liberté d’opinion, elle leur interdit cependant toute critique de nature à compromettre la confiance et le respect que leur fonction doit inspirer au justiciable » ;
Considérant que l’obligation de réserve ne saurait servir à réduire le magistrat au silence ou au conformisme, mais doit se concilier avec le droit particulier à l’indépendance qui distingue fondamentalement le magistrat du fonctionnaire ;
Considérant que le Président de la République est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, en application de l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que l’indépendance des magistrats a donc le caractère d’un principe de droit public et de valeur constitutionnelle ;
Considérant que l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que « le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet... et les auditeurs de justice » ; que ce principe consacre l’unité de la magistrature ;
Que l’unité du corps judiciaire se traduit en pratique, par l’identité des règles de recrutement et des modalités de l’avancement et par l’alternance possible, dans une même carrière, d’affectations au siège et au parquet ;
Qu’ainsi l’indépendance des magistrats du ministère public est égale à celle des magistrats du siège, sous réserve, en ce qui concerne ces derniers, de certaines dispositions dont l’inamovibilité et la compétence du Conseil supérieur de la magistrature ; que les règles particulières auxquelles sont soumis les magistrats du ministère public procèdent de la seule nature des fonctions, l’exercice de l’action publique expliquant et justifiant les pouvoirs conférés par la loi au ministre de la justice ;
Que prétendre à l’entière soumission des magistrats du parquet à une hiérarchie dont le garde des sceaux serait le chef, n’aboutirait, ainsi qu’il a été souvent observé, qu’à discréditer la justice en ne faisant du parquet que l’auxiliaire du pouvoir exécutif ;
Que l’histoire de notre justice enseigne que le ministère public, dans une longue tradition qui remonte au début du siècle dernier, a toujours exigé le respect de son droit à l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions ;
Que, par exemple, le procureur général Bellart (Paris), en 1819, écrivait au garde des sceaux en ces termes : « Ministre de la loi, c’est de la loi seule qu’il [le ministère public] tient sa mission ; c’est à elle seule qu’il répond de ses fautes judiciaires » ;
Que dans une circulaire du 24 novembre 1930 qui conserve toute son actualité, le garde des sceaux Cheron écrivait : « J’entends en matière de poursuites pénales, quelles que soient les personnes en cause, que les chefs des parquets se décident d’après les seules inspirations de leur conscience, dans le cadre des prescriptions de la loi. Dans ma pensée, cette mesure est destinée, en développant le sentiment de la responsabilité chez les représentants du ministère public, à élever encore leur conscience professionnelle et à fortifier l’indépendance de la magistrature, garantie essentielle de notre droit public » ;
Considérant par ailleurs que les procureurs de la République, parallèlement à la conduite de l’action publique, sont tenus depuis quelques années de participer aux travaux des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance dont ils sont respectivement vice-présidents et membres de droit, ainsi qu’à ceux des commissions régionales pour le développement social des quartiers, et de s’intéresser ainsi directement, sous des aspects autres que répressifs, à la délinquance et à la criminalité dans leur ressort ;
Que la volonté légitime manifestée ces dernières années de permettre à la justice, et en particulier aux magistrats des parquets qui sont en charge de l’ordre public, de mieux communiquer avec les autorités locales et l’opinion publique, implique qu’il leur soit permis de s’exprimer sur les problèmes sociaux dont ils ont à connaître dans l’exercice de leurs fonctions et de s’interroger, à la lumière de leur expérience, sur l’efficacité de leur action ;
Considérant que le grief fait à M. X de s’être livré à une démonstration de nature politique, incompatible avec la réserve que lui imposaient ses fonctions, doit être examiné compte tenu de ces observations ;
Considérant que M. X, qui n’a préconisé l’indulgence des traitements sociaux que pour les seuls usagers et reconnu la grave nocivité de la drogue, après avoir comparé les effets de la toxicomanie à ceux d’autres dangers qui menacent la société, tels l’insécurité routière et l’alcoolisme, a détaillé les conséquences de l’interdiction de la drogue et de la répression de la toxicomanie qui remontent à la loi du 25 juillet 1845, et a dressé le tableau des « effets pervers » qui s’attachent selon lui à toute interdiction, tirant exemple de la prohibition de l’alcool édictée en 1919 aux États-Unis ;
Que l’orateur a ensuite exprimé l’opinion selon laquelle « la marée de la toxicomanie, comme celle de l’alcoolisme, s’élève inexorablement jusqu’à un étiage définitif où elle se stabilisera, et qu’alors il faudra bien s’en accommoder » ;
Qu’en conclusion de son discours, M. X, déclarant vouloir apporter « la contribution d’une réflexion de plusieurs dizaines d’années, sur l’efficacité de la sanction dans des domaines où l’évolution des mœurs prend un caractère inéluctable », a souligné « les limites que l’on doit assigner à la répression » qui ne peut être l’unique « remède à des carences éducatives ou à des difficultés d’insertion sur lesquelles la justice n’a aucune prise » ;
Que le caractère utopique d’une société où l’usage des stupéfiants et toxiques de toutes natures ne serait pas sanctionné par la loi, ne permettait pas de considérer les propos tenus à la fin de son discours par M. X comme l’exposé sérieux d’une alternative plausible à la politique de prohibition et d’interdiction édictée par la loi en France comme dans la plupart des autres pays, ni comme les lignes directrices d’une politique pénale que ce magistrat aurait envisagé, voire entendu mettre en œuvre et appliquer aux instances dans lesquelles il a par fonction le devoir de requérir l’application de la loi ; qu’il est du reste établi que la toxicomanie est combattue dans le ressort du tribunal de grande instance de V avec la même fermeté qu’ailleurs ;
Qu’entendu au cours de l’enquête et de l’audience du 8 octobre 1987, M. X a souligné qu’il s’était exprimé sur un ton ironique qui d’ailleurs n’avait pas échappé à l’assistance ;
Que le procureur général près la cour d’appel de A, également entendu, a déclaré avoir considéré le discours du procureur de V comme inopportun « sans qu’il ait été choqué outre mesure » et qu’en l’écoutant il ne l’avait pas trouvé particulièrement provocateur compte tenu du ton sur lequel il était prononcé, estimant qu’il pouvait, à la lecture, donner une impression différente ; qu’au demeurant le préfet, commissaire de la République du département, bien qu’ayant entendu le discours, n’en a pas moins volontairement invité M. X, le 9 février 1987, à participer aux travaux du comité départemental de la lutte contre la toxicomanie, organisme nouveau qu’il avait créé ;
Que la commission observe qu’à la date où le discours a été prononcé, et depuis plusieurs mois, un vaste débat était mené à l’initiative du garde des sceaux sur le traitement le mieux approprié de la toxicomanie ; que la presse avait fait état d’opinions divergentes, jusqu’au sein du gouvernement ;
Considérant en outre, qu’au début de 1987, le garde des sceaux n’avait pas publiquement défini de manière précise, moins encore entrepris de promouvoir selon les voies habituelles une politique pénale nouvelle en matière de toxicomanie ;
Que M. X, dans ses explications, a d’ailleurs fait valoir qu’aucune directive particulière récente n’avait été adressée à son parquet et que la position des autorités telle qu’elle résultait des déclarations publiques, ne permettait pas, selon lui, de discerner une ligne précise dans l’application de la loi et l’exercice de l’action publique ;
Considérant que lors de la création des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance par le décret du 8 juin 1983, le conseil national de prévention de la délinquance a décidé de suivre plus particulièrement les travaux de dix-huit conseils communaux de prévention dont celui – mis en place à l’initiative du conseil municipal – de V ; que le ministère de la justice, souhaitant suivre les actions menées dans ces instances, auxquelles les magistrats étaient appelés à participer activement, et en dresser le bilan, a par dépêche du 28 mars 1984 choisi le tribunal de grande instance de V et celui de B comme juridictions « pilotes » ; que dès lors le tribunal de V, associé au ministère de la justice qui lui a fourni les moyens en matériel et en personnels nécessaires, a conduit de manière originale les actions parfois expérimentales en matière de contrôle judiciaire, de travail d’intérêt général, d’aide aux victimes, de traitement des plaintes, de conciliation pénale et de prévention ; que le problème de la toxicomanie a fait l’objet d’études particulières au sein de ces instances ;
Que s’explique dans ce contexte que le procureur de la République près cette juridiction ait porté une attention particulière, le cas échéant critique, sur l’efficacité de son action et ait souhaité faire partager son expérience ;
Considérant que M. X n’a critiqué ni la loi en vigueur, ni un acte du gouvernement, ni la politique mise en œuvre par le garde des sceaux, et moins encore par le gouvernement, mais qu’il a évoqué le principe social d’interdiction de la drogue observé depuis plus d’un siècle par toutes les nations, et ses conséquences, et a cru pouvoir en déduire le caractère inéluctable de l’accroissement de la toxicomanie et mettre en garde l’assistance quant à l’inefficacité de sa répression, à laquelle devrait être préférée la prévention, exprimant ainsi une opinion personnelle, présentée comme telle, sur un problème de société dont la gravité et les aspects dramatiques étaient soulignés ;
Que de telles considérations ne réalisent pas une démonstration de nature politique et que si l’atteinte au devoir de réserve peut résulter de propos injurieux, voire simplement excessifs ou volontairement provocants, elle ne peut être constituée par la simple expression d’une pensée non-conformiste ;
Considérant en conséquence que les propos de M. X, exprimés sous le bénéfice de la liberté de parole à l’audience, relatifs à un problème de société, pour intempestifs, maladroits et mal compris qu’ils aient été, ne constituent ni dans les termes ni dans l’intention de leur auteur une démonstration de nature politique, ne renferment pas un manque de déférence à l’égard du garde des sceaux et ne caractérisent pas à la charge du procureur de la République de V un manquement au devoir de réserve ou aux obligations nées de la subordination hiérarchique ;
Par ces motifs,
La commission, après en avoir délibéré à huis clos, émet l’avis suivant :
Les faits reprochés à M. X ne caractérisent pas à sa charge une faute disciplinaire pouvant entraîner une sanction ;
Dit que le présent avis sera transmis à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins du procureur général près la Cour de cassation, président de la commission de discipline du parquet.
Annexe : texte du discours
Je vais vous demander dans un instant, M. le président, de déclarer ouverte l’année judiciaire 1987.
Ce n’est pas pour autant que nous serons fixés sur ce qu’elle sera.
Cependant, compte tenu des déclarations d’intention de ceux qui ont en charge l’ordre public, on peut présumer la mise en œuvre prochaine d’un certain nombre d’orientations qui, pour récentes qu’elles soient, s’émancipent d’une désuétude dans laquelle on les croyait enlisées.
Plutôt que de me livrer au long exercice de les examiner toutes, j’ai préféré choisir un sujet, le tenir pour exemplaire, et en tirer un certain nombre de réflexions d’ordre général.
Mon choix s’est porté sur le problème de la toxicomanie. On sait à quel point ce sujet préoccupe l’opinion. Cette préoccupation est légitime. Mais ma première réflexion est de surprise devant l’ampleur prise par la question dans l’agitation générale. C’est en termes alarmistes, en effet, qu’on entend couramment parler du fléau de drogue. Certes, le sujet est grave, et le danger réel. Mais est-on certain de ne pas atteindre parfois la démesure ? Ainsi a-t-on pu récemment entendre un personnage haut placé, comparer les dégâts de la toxicomanie à ceux d’une guerre.
Il y a chaque année en France 120 morts par « overdose ». Mais parlons des guerres :
- celle de 14-18 a fait 8 millions de morts, parmi lesquels 1 600 000 jeunes français ;
- celle de 39-45 a fait 40 millions de morts si on y inclut les victimes des camps d’extermination nazis ;
- actuellement, deux pays encore suffisamment immatures pour guerroyer, comptent déjà un million de disparus dans un conflit stupide.
Ces chiffres, comparés aux 120 toxicomanes, donnent une idée de l’enflure verbale par laquelle on alarme l’opinion sur un sujet, certes dramatique, mais à propos duquel l’intoxication, psychologique celle-là, paraît déplacée.
Le véritable danger pour le corps social, la véritable insécurité pour les personnes, viennent d’autre part, d’événements et de comportements qui nous côtoient, mais que personne ne dénonce.
Je veux dire, pour reprendre le nombre de 120 morts par an, qu’il faut le rapporter aux 12 000 victimes d’accidents mortels que fait la circulation automobile chaque année et, mieux encore, aux 80 000 morts dues à l’alcoolisme.
Or, on parle à peine des accidents de la route, et pas du tout de l’alcoolisme, comme si on redoutait les véritables fléaux, d’autant moins qu’ils sont plus dangereux, et comme si le souci qu’on prenait à s’en préserver était d’autant plus grand que le danger est plus mince.
Qu’on me comprenne bien, et c’est là que ma deuxième idée rejoint la première : je ne veux pas, à la démesure, ajouter l’intolérance. Je ne mène pas de croisade contre l’alcoolisme et je n’ai aucune envie de pourfendre les pourvoyeurs d’alcool.
Je souligne seulement la tolérance dont bénéficie l’alcoolisme, peut-être même l’indifférence, voire la complaisance.
Parlez d’un tel qui, hier, s’est copieusement enivré, vous ne susciterez autour de vous que réflexions amusées et sourire de connivence. Dites, au contraire, devant le même auditoire et à propos du même personnage, qu’on l’a surpris aujourd’hui s’adonnant à un dérivé du cannabis, du pavot ou du coca, et vous verrez aussitôt les sourires se figer et les visages se fermer.
C’est que, me dira-t-on, l’usage de stupéfiants est dangereux.
J’en conviens tout à fait.
Mais que, dans un discours sur les dangers de la toxicomanie, l’on remplace le mot « drogue » par le mot « alcool », et je demande qu’on examine si le discours aura perdu de sa cohérence.
La seule différence entre les deux phénomènes est celle de l’interdiction légale.
Or, ma deuxième idée est précisément d’inviter à réfléchir sur le sens et la portée de cette interdiction.
Elle remonte dans le temps à la loi du 18 juillet 1845.
Elle n’a cessé depuis d’être inscrite dans nos textes répressifs jusqu’au code de la santé publique (L. 627).
La première brèche dans ce processus prohibitionniste apparaît non pas dans la loi, mais dans une circulaire du 17 mai 1978, diffusée par la chancellerie après le rapport de Mme Pelletier sur la toxicomanie, et invitant les procureurs à ne plus poursuivre les usagers de haschich ou de marijuana, sauf à les adresser au corps médical ou à des associations spécialisées. Il faut noter qu’il ne s’agissait que d’une circulaire, en contradiction, d’ailleurs, comme il arrive parfois, avec la loi, mais qui avait le mérite nouveau de proposer une véritable dépénalisation de l’usage de la drogue.
Ses dispositions sont actuellement remises en question dans un contexte polémique intéressant à analyser.
Or, il faut le dire tout net, depuis un siècle et demi d’interdiction et de répression, et de lois de plus en plus sévères, le phénomène ne cesse de s’étendre et le nombre des intoxiqués d’augmenter.
Sans aller jusqu’à dire que la sévérité croissante de la loi favorise le fléau, au moins peut-on énoncer comme une vérité d’évidence qu’elle n’est d’aucun secours pour l’endiguer, et que l’interdiction ne sert à rien.
Mieux encore, elle a les effets pervers de toutes les interdictions, et par exemple :
- elle favorise le trafic ;
- elle renchérit les produits en raison des risques encourus par les trafiquants ;
- elle induit une délinquance spécifique destinée à se procurer des fonds pour l’achat de drogues chères ;
- elle incite à l’altération des produits, les rendant plus dangereux encore.
Qu’on songe aussi à l’interdiction de la vente libre des seringues, interdiction à l’origine de la propagation du SIDA.
Pour mieux illustrer ce que je veux dire, je propose d’évoquer ce qu’a été aux États-Unis, de 1919 à 1933, l’époque de la prohibition de l’alcool : contrebande, trafic, corruption, débits clandestins, boissons frelatées, apparition d’une mafia, règlements de comptes sanglants.
Le remède était pire que le mal, et la levée de la prohibition en 1933, si elle n’a pas fait disparaître l’alcoolisme, a au moins dépouillé ce vice d’un environnement déplorable qui le rendait plus odieux encore.
En somme, pour l’alcool comme pour la drogue, les effets de la prohibition ne sont que négatifs.
Mais de telles évidences sont difficiles à énoncer quand elles heurtent si catégoriquement l’opinion dominante.
On les considère comme provocatrices, alors que la voix qui les profère n’est remplie que d’angoisse, de l’angoisse du paralytique qui voit l’aveugle qui le porte s’engager dans une voie sans issue.
Il faudra bien un jour admettre que la marée de la toxicomanie, comme celle de l’alcoolisme, s’élève inexorablement, avec ou sans prohibition, jusqu’à un étiage définitif où elle se stabilisera, et qu’alors il faudra bien s’en accommoder.
Ce sera la tolérance à la drogue, après la tolérance à l’alcool.
A ce propos, je ne résiste pas à l’envie de citer une phrase amusante de Cocteau :
« Puisque ce mystère nous dépasse,
Feignons d’en être l’organisateur... »
et, la transposant à notre sujet, de dire :
« Puisque ce phénomène nous dépasse,
Pourquoi ne pas l’organiser ? »
Permettez-moi de m’en tenir là, car je n’ai pas l’intention de dresser un tableau de ce que serait une société ouverte aux stupéfiants,
- où le trafiquant se transformerait en honnête importateur, et le petit revendeur en tenancier de débit sans reproche,
- où le service des fraudes s’intéresserait à la qualité des produits,
- où le corps médical prendrait en charge les consommateurs excessifs, et
- où il faudrait bien que la brigade des stupéfiants se reconvertisse.
J’ai dit que je voulais tirer de mon sujet une conclusion d’ordre général.
Je souhaiterais que l’exemple choisi ait montré les limites que l’on doit assigner à la répression.
J’ai bien conscience que c’est un langage inattendu dans la bouche d’un procureur.
Mais je voulais, pendant un instant, m’exprimer en citoyen, un citoyen certes habitué depuis longtemps à considérer ces choses d’un point de vue privilégié, mais désireux d’apporter au corps social dont il se sent solidaire, la contribution d’une réflexion de plusieurs dizaines d’années sur l’efficacité de la sanction dans des domaines où l’évolution des mœurs prend un caractère inéluctable.
Et je voudrais par là qu’on cesse d’attendre de la répression le remède à des carences éducatives ou à des difficultés d’insertion sur lesquelles la justice n’a aucune prise.
Car je suis las, oui vraiment las, de m’entendre crier aux oreilles :
« Mais que fait donc la justice ! Qu’attendez-vous pour les mettre en prison ? »